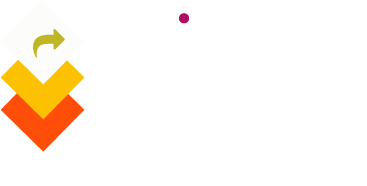Anthropologue et professeur des universités à l’Institut National des sciences de l’archéologie et du patrimoine à Rabat, Naïma Chikhaoui distingue les notions de bienfaisance et de solidarité au Maroc et revient sur le rôle des associations dans ce domaine.
Solidarum : La solidarité est l’une des valeurs fondamentales de la société marocaine. Pouvez-vous revenir sur ces différentes composantes traditionnelles ?
Naïma Chikhaoui : La solidarité au Maroc repose traditionnellement sur deux éléments fondamentaux. Le premier, d’ordre tribal ou ethnique, est presque obsolète aujourd’hui, ou du moins en voie de démantèlement. Le deuxième est d’ordre religieux.
La première forme s’établissait autour de la communauté et était liée à ses besoins dans une « écologie culturelle » donnée. C’est une solidarité qui était normée, régulée, fonctionnant comme un capital social auquel on se réfère, et qui demeura longtemps – voire qui est susceptible de continuer à s’exercer dans certaines régions. On peut prendre comme exemple la restauration des maisons en terre ou constructions en pisé, pratiquée par tous les membres de la communauté villageoise, les hommes effectuant la restauration, et les femmes se chargeant de préparer le repas collectif et souvent de transporter l’eau, tâche reconnue pour être pénible. À l’origine, ce système, qui porte le nom de « touiza » ou « twiza », correspondait à un travail corvéable sans rémunération, établi dans des rapports hiérarchisés entre « maîtres » et personnes dites subalternes (labour, construction, etc.). Ce mode social de travail a évolué vers la constitution d’un système d’entraide villageois, plus précisément d’assistance mutuelle avec une périodicité saisonnière (labour en automne, construction de l’habitation au printemps, etc.). Ce système de solidarité-là est propre au milieu rural. Mais des équivalents pouvaient s’observer à l’occasion de certains événements festifs ou rituels (comme par exemple une sorte de don contre don circulaire entre voisins, à l’occasion des travaux de préparation de ces manifestations).
La seconde composante de la solidarité au Maroc, d’ordre religieux donc, tourne autour de la notion de bienfaisance. C’est une pratique très codifiée de la solidarité, qui se décline à la fois par la communauté et par le croyant qui acte sa foi en aidant toute personne dans le besoin. L’aumône individuelle, à la fin du mois de jeûne, pour les nécessiteux, les pauvres, les veuves, les orphelins, les mendiants représente l’un des cinq piliers de l’Islam. Elle se pratique par des dons en nature ou en argent. Cet acte religieux a en somme pour visée le « rachat » de ses erreurs, afin de mériter l’accès au Paradis. Cette motivation religieuse, qui reste fondamentale, explique la persistance de cette pratique dans le Maroc actuel.
Quelles sont les différentes formes de solidarité pratiquées aujourd’hui ?
Il y a plusieurs formes de solidarité au Maroc, qui reflètent la complexité du tissu associatif marocain et qui peuvent se retrouver en situation de conflit les unes avec les autres.
D’un côté, il y a les associations qui défendent une solidarité comme pratique citoyenne, pour un service décent et de qualité. Dans les années 1970 et 1980, après un ajustement structurel, le pays a encouragé l’émergence des associations comme acteurs de proximité et de relais – la solidarité pouvant ainsi reposer sur un agent de terrain. Et ces dernières décennies, on a vu également une explosion des associations autour des droits des femmes et d’autres surgies dans la foulée du chantier royal de l’INDH (Initiative nationale pour le développement humain, cf. plus bas). Celles-ci se sont multipliées, autour des notions de développement et avec des bailleurs de fonds internationaux de l’humanitaire ou des partenariats bilatéraux.
De l’autre côté, il y a les associations qui utilisent la solidarité pour se positionner aux côtés des partis politiques à référentiel religieux dans un échiquier politique dépendant d’agendas électoraux. Cette habitude partisane, de mettre en place des associations sympathisantes, est courante, notamment avec des partis dits progressistes ou de gauche. Mais ces partis sont restés plutôt éloignés des actions de solidarité charitable, au contraire de ceux qui se revendiquent du référentiel islamique. Les associations de bienfaisance sont implantées dans les quartiers populaires, dans des zones urbaines ou préurbaines souffrant de vulnérabilités et de précarité sociales, qui constituent une masse électorale importante. Les références religieuses exprimées à travers ces formes nouvelles ou traditionnelles de solidarité posent problèmes en termes de transformations sociales et politiques. Cela fausse les choses et retarde le déploiement de nouvelles pratiques, délibérément citoyennes et apolitiques.
Comment les modèles de solidarité traditionnels reposant sur la communauté, ont-ils évolué ces dernières décennies ?
Prenons, par exemple, la problématique des jeunes femmes, lorsqu’elles se retrouvent enceintes en dehors de l’institution légale du mariage, généralement à cause de grossesses non désirées. Ces mères dites célibataires ont toujours été rejetées ou stigmatisées, mais pendant longtemps, elles faisaient l’objet d’une solidarité communautaire. La jeune fille était hébergée chez une tante qui habitait loin du foyer parental, ou l’enfant était confié de manière discrète à un proche de la famille. Finalement, on négociait avec les valeurs traditionnelles pour servir une forme de solidarité humaine. Celle-ci s’est effritée. Ce qui perdure aujourd’hui est la stigmatisation de ces femmes, un processus de victimisation atroce de ces jeunes Marocaines qui se retrouvent complètement marginalisées. L’association Solidarité féminine, créée à Casablanca par Aicha Ech-Chenna, a été pionnière dans une conception moderne de la solidarité. La mise en place de cette association est un indicateur de taille signifiant une transformation de la solidarité. La fondatrice a compris très vite que ces femmes ne devaient compter que sur elles-mêmes, c’est–à-dire qu’elles devaient être autonomes économiquement, pour ne pas abandonner leur enfant et pouvoir vivre dignement. L’appel à la solidarité est, au-delà du discours qui le sous-tend, de rendre visibles ces femmes et de dénuder le stigmate qui les frappe.
Prenons un autre exemple, celui des personnes âgées qui vivaient, jusqu’à il y a quelques temps, dans les familles. Cette prise en charge est devenue très difficile avec l’exigüité des appartements ou la mobilité des enfants qui partent travailler loin de leur foyer d’origine. On voit l’émergence de résidences spécialisées pour accueillir ces personnes, parfois gérées par des associations. On voit que beaucoup d’évolutions sociales comme la revendication de l’individualité, l’émergence du couple, la famille nucléaire, l’essor urbain, ont fait évoluer ce modèle traditionnel de solidarité basé sur la communauté. Cette évolution met en crise le modèle traditionnel, laissant place à une étatisation et à des politiques publiques pour assurer une vie décente à ces personnes souvent abandonnées. La solidarité intergénérationnelle devrait se renouveler et se donner de nouveaux sens.
Quels sont aujourd’hui les problèmes que pose selon vous la solidarité de bienfaisance, au départ d’ordre plutôt religieux ?
En privilégiant ce type de solidarité, le pays a du mal à rentrer dans une gouvernance moderne. Par exemple, le don doit rester discret car toute aumône réalisée discrètement rapproche un peu plus de Dieu. Ce principe complique une comptabilité en toute transparence. Dans cette conception traditionnelle de la solidarité, les notions de bénévolat, d’engagement citoyen sont remplacées par celles de faire le bien ou d’être un bon croyant. Il s’agit d’une solidarité idéalisée, sublimée. Les inégalités sociales se naturalisent. C’est l’air du « On n’y peut rien, c’est ainsi, c’est le bon Dieu qui a créé la richesse et les inégalités ». Dès lors, toute charité est un miroir qui renforce la personne aidée dans sa situation et l’éloigne d’une justice sociale. Il s’agit d’une solidarité non active, qui ne garantit pas la dignité, la responsabilité citoyenne et civile. Dans cette conception, la solidarité n’est pas un levier de développement mais une opération de rafistolage, du bricolage. Sauf que la population n’est pas dupe. Elle remet en cause cette solidarité traditionnelle, idéaliste ou de bienfaisance. Elle se tourne de plus en plus vers la responsabilisation politique, le discours des droits fondamentaux, la remise en cause des inégalités sociales.
En mai 2005, le roi Mohamed VI a mis en place l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), un programme de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale. Pouvez-vous revenir sur ce programme ?
Lors de son lancement en 2005, la feuille de route de l’INDH était sophistiquée, par son aspect multidimensionnel. Elle traitait à la fois des questions économiques, sociales, culturelles et politiques. Elle s’adressait à un citoyen en pleine possession de ses droits, avec un langage de politique publique. Il s’agissait d’une solidarité rationnalisée, institutionnelle, avec un objectif de convergence territoriale, même si ce concept y était embryonnaire. Pour prétendre à cette solidarité, les personnes devaient s’organiser en associations, avoir un programme. C’est une conception moderne, avec une cartographie de la pauvreté établie par les institutions légales, en particulier le haut commissariat au plan qui a identifié des poches de pauvreté et les quartiers les plus vulnérables.
Mais le discours et la médiatisation du chantier royal de l’INDH s’appuient paradoxalement sur la solidarité comme bienfaisance. Sa mise en place s’est vue complexifier par un processus d’instrumentalisation politique de la société civile qui s’est élargi à partir des élections de 2007 pour se consolider depuis 2010 et 2011. Certains partis politiques, dont l’un est entré au gouvernement (NDLR : le Parti de la justice et du développement, le PJD, majoritaire au parlement et qui dirige le gouvernement), a utilisé cette notion de bienfaisance pour avoir un bassin électoral large. On ne peut pas écarter cette instrumentalisation de la solidarité qui fait même l’objet de blagues dans le discours populaire, et suscite parfois des faits divers.
Quel bilan peut-on faire de ce programme qui vient de rentrer dans sa troisième phase (2019-2023) ?
La dynamique de l’INDH repose sur la reconnaissance de poches de pauvreté. C’est une avancée symbolique et pragmatique. Avec le recul, on ne peut que constater un problème de compréhension ou d’interprétation de la feuille de route de l’INDH. La question de l’autonomie et de la participation à la prise de décision ne reste que de l’ordre du discours. C’est un échec quant aux résultats attendus en termes de développement humain. La paupérisation n’a pas diminué, l’emploi ne s’est pas amélioré, et les projets mis en place n’ont pas été efficients. Le souverain a appelé en septembre 2018 à une révision chirurgicale du chantier. Les responsables ont compris qu’il faut prioriser les besoins et les effets stratégiques de l’INDH, par exemple en se tournant plus vers les jeunes et les femmes. Des besoins très élémentaires sont de plus en plus fréquemment privilégiés : des espaces de proximité, les terrains de sports, des aires de jeux. Un autre chantier de l’INDH porte sur la gouvernance participative, mais c’est un terrain épineux. Sa réussite nécessite de s’attaquer à la corruption, à la gestion illicite des biens publics. C’est un défi difficile mais inévitable.
Quelles sont aujourd’hui les attentes des Marocains ?
La population n’a plus ce discours de demande d’aumônes, elle ne croit plus à une solidarité qui serait « naturelle ». Même dans les endroits les plus reculés, les individus revendiquent un droit à la solidarité basé sur la responsabilité politique gouvernementale et pas uniquement sur les communautés traditionnelles. Cette revendication du droit à l’équité et à la justice sociale n’est pas nouvelle : les manifestations de rues spontanées n’ont pas attendu le printemps arabe de 2011. La prise de conscience par les technologies de communication y joue un grand rôle. Le fait divers le plus anodin filmé à Rabat peut désormais se voir dans les zones les plus reculées et enclavées du pays.
Aujourd’hui dans ce débat sur la solidarité, comment se positionnent les associations de la société civile ?
Elles se sont professionnalisées et leurs postures sont plus franchement déclinées et assumées. Elles ne souhaitent plus jouer ce rôle de relais de structures sociales et de solidarité hypothétiques, mais revendiquent une implication participative et inclusive. Elles revendiquent l’autonomie, mais également une participation accrue de l’État, notamment financière. La nouvelle constitution de 2011 leur accorde une place de choix. Elles peuvent susciter des pétitions ou des projets de lois qui seront portés par les partis politiques. Pour la plupart d’entre elles, ces associations sont appelées à devenir des acteurs incontournables. Elles revendiquent de ne plus être de simples agents relais. Elles refusent le discours de charité, la pratique de l’assistanat, et veulent être de vrais acteurs sociaux avec des propositions pour traiter les problèmes sociaux et de solidarité à la source.