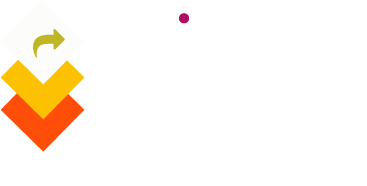À Marseille, la psychiatre et chercheuse Aurélie Tinland met en pratique le concept de rétablissement, en donnant une place centrale aux pairs-aidants – personnes qui, ayant vécu ou vivant encore avec des troubles psychiques, peuvent prendre une place de guides – en appelant à une vision plus complexe et surtout partagée avec les personnes touchées par les maladies mentales.
Les pratiques et recherches d’Aurélie Tinland sont orientées sur le rétablissement des personnes, ou Recovery en anglais, un concept développé dans les années 1980-1990 aux États-Unis par le mouvement des usagers de la psychiatrie. Déjà au début de ce mouvement, celles et ceux qui se faisaient appeler « les survivants de la psychiatrie » se sentaient en profond désaccord avec un système de soins psychiatriques focalisé sur la maladie et ses symptômes, sans prise en compte des conséquences des soins sur la vie des personnes (privation de liberté, maltraitance, effets secondaires des médicaments, perte d’espérance de vie, etc.). Tel qu’il se développe désormais en France, le mouvement du rétablissement vise à rééquilibrer les relations entre soignants et soignés, partant du principe que les personnes malades sont en capacité d’apprendre et de produire du savoir grâce à leur expérience et à leurs échanges.
Aurélie Tinland est rattachée au laboratoire CEReSS (Centre d'études et de recherche sur les services de santé et la qualité de vie) au sein d’Aix-Marseille Université. Elle mène également une activité clinique dans le service du Pr Lançon à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (APHM). Avec cette double casquette de psychiatre et de chercheuse en santé publique, elle a participé à différents programmes alternatifs sur la question de la santé mentale, tout d’abord avec MARSS (Mouvement et Action pour le Rétablissement Sanitaire et Social), une équipe de chercheurs, soignants et travailleurs pairs, fortement engagé auprès des personnes en grande précarité. Parmi ces programmes : « Un chez soi d’abord », le Lieu de Répit ; « Alternative à l'incarcération par le logement et le suivi intensif » (AILSI) pour les personnes jugées pour délits mineurs et atteintes de troubles psychiques ; et le « CoFor », un centre de formation au rétablissement par les pairs.
Solidarum : Quelle est votre expérience et votre vision de la psychiatrie ? Et où vous situez-vous en tant que soignante ?
Aurélie Tinland : J’ai d’abord été une professionnelle gênée par les pratiques psychiatriques. Ce qui m’a marqué lors de mon premier stage en psychiatrie, c’est que nous portions toujours des clés sur nous. Nous détenions le pouvoir d’enfermer d’autres personnes. Il y avait une omniprésence de la violence. En France, le fort recours aux médicaments et aux pratiques d’enfermement des patients s’explique par le manque de moyens, mais aussi par une organisation des soins psychiatriques trop centrée sur l’hospitalisation. Les personnes malades entrent en soin dans les moments de crise, il n’y a pas assez de prise en charge globale des personnes dans leur environnement de vie, ni suffisamment de moyens mis sur la prévention et l’accompagnement. Je n’ai jamais réussi à me convaincre de la nécessité de ce système de soin que je vivais comme maltraitant.
D’autres organisations sont possibles et il n’est pas nécessaire d’aller chercher très loin. Prenons l’exemple de l’Italie, dans les années 1960, le psychiatre Franco Basaglia s’est battu pour la fermeture des asiles, fondant le mouvement pour une psychiatrie démocratique et obtenant gain de cause, deux ans après sa mort, avec l’adoption de la loi 180. Aujourd’hui, en Italie, tous les soins psychiatriques se déroulent donc en ambulatoire et sans contrainte, et il n’y a pas plus de crimes violents commis par des personnes avec des troubles psychotiques aigus en Italie qu’en France… Avant ces avancées en Italie puis à la même époque en France, François Tosquelle à l’hôpital Saint-Alban et à sa suite Jean Oury avec la clinique de Laborde ont également lancé un mouvement critique envers l’institution psychiatrique, cherchant à inventer d’autres manières de prendre soin des malades. Mais, en définitive, cette « psychothérapie institutionnelle » a échoué à vraiment remettre en question dans les institutions le pouvoir des psychiatres, la médicamentation forcée ou encore l’hospitalisation sous contrainte. Donc, comme soignante, je m’inscris sans hésiter dans l’héritage de Franco Basaglia et dans une vision d’une société qui ne vient ni exclure, ni tenter de rendre à tout prix « normales » des personnes avec des troubles psychiques, mais qui considère au contraire leurs différences de fonctionnement psychique comme une richesse, au-delà des souffrances associées, qu’il faut évidemment accompagner et soulager.
En 2009, vous intégrez l’équipe mobile « psychiatrie et précarité », dirigée par le psychiatre Vincent Girard à Marseille. Que retenez-vous de cette expérience auprès des personnes vivant dans la rue et souffrant de troubles psychiatriques sévères ?
Cette expérience m’a tout simplement réconciliée avec le fait de devenir psychiatre, car j’y ai découvert des pratiques en phase avec mon éthique médicale et dont je peux constater les effets positifs sur les personnes que nous accompagnons.
L’équipe mobile est composée de psys (psychologue et psychiatres), de travailleurs sociaux et également de travailleurs pairs, c’est-à-dire de personnes ayant vécu ou vivant encore avec des troubles psychiques, ce qui constitue en soi une différence d’approche énorme par rapport à des équipes psychiatriques classiques. Ensuite, c’est nous qui allons à la rencontre des personnes et non l’inverse. Enfin, nos pratiques visent le rétablissement d’une personne, et pas forcément la rémission.
En psychiatrie, être en rémission, cela signifie que les symptômes ont disparu. Cependant, si, pour y parvenir, cela implique une médicamentation qui fait prendre vingt à trente kilos, inhibe toute vie sexuelle et sociale et réduit de quinze ans l’espérance de vie, est-on sûr que ce soit un objectif souhaitable du point de vue de la personne concernée ? Le rétablissement nous aide à nous décentrer de la vision des professionnels sur la maladie psychique. Et lorsqu’on opère ce changement de point de vue, on se rend compte qu’il n’y a pas forcément de norme sur la question. C’est une démarche complètement singulière qui nécessite à chaque fois de questionner les personnes, de coller à leurs objectifs, à leurs forces, de les aider à identifier leurs compétences et les outils dont elles ont besoin, afin de retrouver une qualité de vie satisfaisante, en dépit de la maladie.
En outre, le rétablissement ouvre à l’acceptation d’une forme de transformation. En effet, les personnes qui entrent dans un processus de rétablissement n’attendent plus nécessairement des médecins qu’ils annulent leur trouble et les ramènent à leur vie antérieure, ils apprennent à vivre avec les aspects résiduels de leurs troubles et à en percevoir certains aspects positifs. Les troubles psychiques représentent énormément de souffrance, et il ne faut pas la sous-estimer, mais en même temps, ils représentent une opportunité de mieux savoir ce dont on a besoin, de faire un certain nombre de deuils sur nos attentes, de nous réorienter, d’être plus à l’écoute de nous-mêmes.
Cela vaut aussi pour les crises. Dans les approches classiques en psychiatrie, on ne considère pas que les crises soient porteuses de sens, on estime que c’est du délire et qu’il faut casser ce délire. Dans les pratiques orientées vers le rétablissement, on est ouvert à l’idée qu’une personne en crise est en train de vivre quelque chose de fort en lien avec son histoire. La crise crée du sens et il est important d’être en capacité de le saisir. Toutefois, laisser s’exprimer une crise présente des risques de passage à l’acte, notamment de suicide, il faut donc peser ces risques et tout faire pour garantir la sécurité de la personne. D’un point de vue général, qu’on soit malade ou non, les crises viennent révéler un dysfonctionnement et nous donnent la possibilité de nous transformer en profondeur.
Le concept de rétablissement a été repris par les structures de soin psychiatriques sous la dénomination de réhabilitation psychosociale, est-ce une réponse valable des structures de soin à cette demande de recentrage sur la vie des personnes et de rééquilibrage des savoirs et pouvoirs de décision ?
L’approche de la réhabilitation psychosociale est clairement un progrès parce qu’elle concourt à l’inclusion sociale et à la déstigmatisation des personnes. En revanche, les structures de réhabilitation psychosociales « de première génération » véhiculent encore cette idée de norme et de retour à la normale. Par exemple, la psychoéducation, un des outils de la réhabilitation psychosociale, est une énorme avancée au regard d’une pratique de soin considérant qu’il est inutile d’informer les personnes sur leurs maladies car elles ne seraient capables ni de les entendre, ni de faire quelque chose de ce savoir. La limite de la psychoéducation, néanmoins, c’est qu’elle transmet des connaissances qui restent normées, c’est-à-dire avec une certaine idée de la maladie : celle des professionnels. On retombe dès lors dans les travers d’une psychiatrie uniquement pensée du point de vue des soignants.
Ensuite, le rétablissement vise une autonomie en santé pour les personnes, terrain où la réhabilitation psychosociale ne s’aventure pas encore complètement. Sur l’enjeu des médicaments par exemple, nous voyons dans nos travaux de recherche que la posture des soignants reste le plus souvent infantilisante, alors qu’elle pourrait évoluer pour favoriser la responsabilité et le consentement des personnes. Lorsque les personnes sentent qu’un traitement leur fait du bien, elles le prennent, mais si les effets secondaires sont trop forts, beaucoup arrêtent de le prendre de façon brutale, sans en parler avec leur médecin. L’arrêt du traitement déclenche alors des crises d’angoisse ou d’autres symptômes en raison de l’accoutumance du corps aux substances. Une pratique issue du rétablissement serait d’apprendre aux personnes à arrêter un médicament sans se mettre en danger, dès lors qu’elles jugeraient les effets du médicament plus néfastes que les manifestations de la maladie – quitte si besoin à en parler à un professionnel.
Enfin, la réhabilitation psychosociale est tout de même une approche médicale, centrée sur la maladie, alors que les pratiques de rétablissement amènent plutôt à considérer la maladie comme étant un des aspects de la vie des personnes, une vulnérabilité parmi d’autres. Le rétablissement se travaille donc aussi et surtout en dehors des structures de réhabilitation psychosociale. Viser le rétablissement permet à la personne de ne pas se résumer à sa maladie, de travailler sur son identité en dehors de la maladie.
Vous parlez d’une réhabilitation de « première génération ». Cela signifie-t-il qu’il y en aurait une de « deuxième génération », plus proche dans ses visions et ses méthodes de la notion de rétablissement telle que vous la défendez ?
Oui, je parle de réhabilitation de « première génération » parce qu’il existe une porosité importante des structures de réhabilitation aux idées du rétablissement, et que les équipes de réhabilitation s’emparent de plus en plus de ces idées, devenant ce que j’appelle des équipes de réhabilitation de « deuxième génération » qui, au lieu de viser la rééducation, s’orientent vers l’accueil de la diversité fonctionnelle.
Je fais ici référence au modèle proposé par Agustina Palacios et Javier Romanach pour décrire l’histoire du traitement social des personnes vivant avec un handicap. Selon eux, il y a d’abord le modèle de l’éradication, où les personnes présentant des différences sont jugées inutiles, cantonnées à la dépendance et à des espaces destinés aux anormaux. La deuxième étape, c’est le modèle de la réhabilitation, où les personnes ne sont pas jugées comme inutiles pour autant qu’elles puissent être réhabilitées. L’objectif est ici la normalisation des personnes différentes. Et il y a enfin le modèle social, qui pose que les personnes peuvent contribuer à la communauté dans une mesure égale à celle des autres, grâce à la valorisation et au respect de leur condition de personnes différentes.
Quelle serait alors la meilleure façon pour les personnes de s’engager dans un processus de rétablissement ?
Chaque parcours de rétablissement est unique, mais selon moi, la psychoéducation par les pairs a un rôle important à jouer… Nous avons tout d’abord expérimenté cette approche avec l’équipe mobile psychiatrie précarité (MARSS), mais notre action se limitait aux personnes vivant dans la rue, ce qui n’est pas une situation propice au rétablissement, car quand on est dans des modes de survie, on mobilise toutes ses ressources pour la préservation de soi au détriment de l’adaptation à ses symptômes.
L’ambition du CoFor, inspiré des recovery college anglo-saxons (université du rétablissement), est de rendre accessible cette approche de psychoéducation par les pairs à tous les usagers de la psychiatrie et d’évaluer son impact de façon scientifique. Nous avons co-construit le projet de A à Z avec des personnes concernées et en collaboration avec le Professeur Lançon, le chef du service de psychiatrie pour adultes au CHU de la Conception de Marseille (APHM). Nous avons poussé à l’extrême tout ce qui relevait de la pair-aidance, de la valeur expérientielle et de la recherche d’autonomie en santé pour les personnes. Il était important aussi que ce projet se déroule en dehors des murs de l’hôpital ; nous avons ainsi été accueillis dans les locaux de l’IRTS (Institut Régional du Travail Social) à Marseille.
Lorsque je parle de co-construction, je parle de six à neuf mois de construction du projet avec des personnes souffrant de troubles psychiques, autant sur le choix du nom que sur l’organisation des modules de formation, le rythme et les horaires des cours et même les modes de gouvernance et de rémunération.
Aujourd’hui, nous avons terminé un premier cycle de quatre ans, qui a permis à plus de 300 personnes de se former au rétablissement. 90 % des personnes qui ont animé les cours étaient pair-aidants. Nous avons réalisé une mesure d’impact quantitative et qualitative qui sera publiée prochainement. Au vu des résultats, nous pouvons dire que le modèle est suffisamment mature pour donner lieu à un essaimage dans différentes villes de France. Au Royaume-Uni, par exemple, il existe 80 recovery colleges.
Pourquoi est-il si important que les pairs aient une place centrale ?
L’implication centrale des pairs permet de se rendre compte que tout le monde ne vit pas les troubles psychiques de la même manière. Certains entendent des voix sans que ce soit une souffrance mentale à proprement parler, d’autres vivent avec des voix stridentes à se taper la tête contre les murs. En partageant leurs astuces pour gérer la manifestation de troubles, les situations de stress ou encore les périodes de dépression, les personnes concernées montrent qu’il y a de nombreuses façons de se rétablir et que chacun doit trouver son propre chemin. Le partage entre pairs déconstruit l’idée de la norme, ou en tous cas, reconstruit une vision plus complexe et plus positive de la maladie psychique.
L’apport des pairs est précieux pour que les personnes qui se découvrent des troubles psychiques n’aient pas une vision trop négative d’eux et de leur futur, ce qui favorise l’acceptation du diagnostic et peut, in fine, améliorer le pronostic. Dans une formation au rétablissement par les pairs, il y a en effet des guides, des personnes qui sont passées par là avant. Il se développe un échange d'expérience qui permet d'outiller les personnes et de leur dire que ce qui leur arrive, arrive à d'autres personnes, et qu’il est possible de vivre avec, qu’il est même possible de bien vivre avec.
Lorsque l’on côtoie des personnes rétablies, plutôt que des personnes qui vont mal, comme c’est le cas dans les hôpitaux psychiatriques, on retrouve de l’espoir et de la motivation, car il se crée des identifications positives. Par exemple, si je rencontre une personne qui arrive à vivre avec ses automatismes mentaux parce qu’elle a mis en place des astuces, alors pourquoi pas moi ? Le premier impact des pratiques de rétablissement est donc de réparer l’image que les personnes ont d’elles-mêmes et de leur maladie, ce qui réduit donc considérablement l’auto-stigmatisation.
Quel impact le concept de rétablissement pourrait-il avoir sur la société en général ?
En s’intéressant plus à la personne qu’à sa maladie ou ses symptômes, en se concentrant sur ses forces plutôt que sur ses déficits et en acceptant la manifestation de certains troubles psychiques, le rétablissement s’inscrit dans une vision plus inclusive des troubles psychiques.
La société dans son ensemble méconnait en effet la réalité des souffrances mentales, parce que nous nous en protégeons tout le temps et parce que nous ne voulons surtout pas être assimilés de quelque façon que ce soit à des malades mentaux et nous retrouver ségrégués comme eux. Pourtant, nous sommes nombreux à vivre des traumatismes qui engendrent des troubles psychiques, que ce soient les hallucinations auditives, les troubles anxieux, les dépressions, les troubles obsessionnels, etc. Tout cela n’est pas si anormal que nous le pensons, c’est même le contraire, parce que nous sommes des êtres humains et qu’au bout d’un moment, la vie fait que, forcément, nous rencontrons des souffrances psychiques. Donc les pratiques de rétablissement, en aidant les personnes malades à vivre ouvertement avec leurs troubles et à partager leurs expériences, donnent la possibilité aux autres de mieux comprendre ce que sont les souffrances psychiques et de sortir du déni. Finalement, en se rendant compte que nous sommes tous concernés d’une manière ou d’une autre, nous comprendrons peut-être que nous gagnons beaucoup à bénéficier de leur expertise vécue en santé mentale plutôt que de les mettre à l’écart et d’en avoir peur.
Données en plus
Données sur le rétablissement
Années 1970-80 : émergence du recovery movement porté par le mouvement des usagers en psychiatrie aux Etats-Unis. Figures emblématiques : la psychologue et chercheuse américaine Patricia Deegan ; Bill Anthony, fondateur du Boston University Center for Psychiatric Rehabilitation.
Données sur le CoFor (Centre de Formation au Rétablissement)
2017-2018 : démarrage du CoFor à Marseille en partenariat avec l’Institut régional du travail social (IRTS), Aix Marseille Université et l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM). Le CoFor est porté par l’association Solidarité Réhabilitation dans le cadre d’un appel à projets national intitulé Accompagnement à l’autonomie en santé lancé en 2016 par le ministère des Affaires sociales et de la Santé. 4 modules constitués de 12 cours : Bien-être/corps, plan de crise, vivre avec, droit/plaidoyer. 12 étudiants par module et 2 facilitateurs. Formation rémunérée à hauteur de 250 euros par module. Entre 2018 et 2021 : 300 personnes ont validé au moins un module.