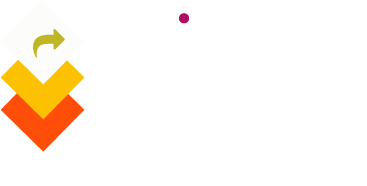La psychiatre Emma Beetlestone interroge la place prépondérante que prend la psychiatrie dans la vie des patients. Elle plaide pour un rééquilibrage entre soins médicaux, accompagnement social et parcours de rétablissement individuel. Soit une évolution s’appuyant sur une pluralité de nouvelles pratiques, l’intervention de travailleurs pairs ou encore la mise en place d’équipes mobiles en psychiatrie.
Solidarum : Quelle est votre parcours en tant que psychiatre et votre vision de la psychiatrie ?
Emma Beeltlestone : J’ai un double parcours en santé publique et en psychiatrie, ce qui m’a donné dès le départ un regard différent sur ma pratique en tant que psychiatre. J’ai débuté à Lille, partageant mon temps entre le service du docteur Jean-luc Roelandt, service pilote du Centre collaborateur de l’OMS (CCOMS), et le programme Un Chez Soi d’Abord, deux initiatives innovantes abordant l’accompagnement et les soins en santé mentale par le prisme de l’ambulatoire, des pratiques orientées rétablissement et de la reconnaissance des travailleurs pairs. Avec ces expériences, j’ai eu le sentiment de désapprendre tout ce que j’avais appris en psychiatrie et d’avoir les moyens de mettre en place une approche des soins psychiatriques dans laquelle je me sentais vraiment utile. Je suis aujourd’hui à l’APHM (Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille) et je travaille au sein de différentes équipes mobiles en psychiatrie et d’accompagnement en milieu ordinaire. À partir de ces expériences, j’ai acquis la conviction que la psychiatrie de secteur ne répond plus fondamentalement aux besoins des usagers.
Que faudrait-il changer dans ce modèle ?
Il s’agit, en premier lieu, de basculer d’un modèle de soins en psychiatrie centré sur l’hospitalisation vers un modèle plus ambulatoire, même lors d’épisodes très aigus. L’hospitalisation ne devrait pas être la solution par défaut, car cela conduit à des situations où des personnes qui ont besoin de se poser ou de se rassurer côtoient des patients en soin très aigus. Ce sont non seulement des expériences qui peuvent être traumatisantes pour ces personnes qui n’ont besoin que d’un accompagnement non médicalisé, mais en plus, dans ces cas-là, les médecins et les infirmiers ont, d’après moi, des compétences trop restrictives, trop strictement médicales pour pouvoir répondre aux besoins de ces personnes.
En outre, la plupart du temps, les patients sont adressés aux urgences psychiatriques puis hospitalisés alors qu’ils préféreraient éviter l’hospitalisation. C’est ce qui ressort de mon utilisation des « directives anticipées incitatives en psychiatrie » à Lille et à Marseille. Inspirées des « directives anticipées en fin de vie » de la loi Leonetti de 2005 et des crisis plans (plans de crise), il s’agit de consignes rédigées par les personnes souffrant de troubles psychiques exprimant par anticipation ce qu’elles veulent et ce qu’elles ne veulent pas en cas de nouvelle crise. Les personnes, même souffrant de symptômes psychiques persistants et invalidants, ont des moments de bien-être qui leur permettent de rédiger ces directives. Et, donc, dans l’état actuel, il est quasiment impossible de respecter leur souhait, puisqu’en France il n’y a que l’hôpital…
Je ne dis pas que l’hôpital doit disparaître mais que l’hospitalisation doit être réservée aux rares situations nécessitant une surveillance médicale constante ou des équipements techniques impossibles à déployer ailleurs. L’hôpital ne devrait jamais être un lieu de vie, même temporaire, d’autant que l’activité d’hébergement à l’hôpital coûte très cher et que les moyens financiers et humains pourraient être redirigés sur l’offre de soin, réduisant ainsi la surcharge de travail des soignants et les temps d’attente pour les patients.
Pour toutes ces raisons, je suis en désaccord total avec l’idée de remettre de l’hospitalité dans l’hôpital. Au contraire, il serait bénéfique pour les patients comme pour les soignants que l’hospitalisation se recentre sur le médical. Il est possible de proposer un accueil humain et respectueux des droits et des choix des patients, sans pour autant devenir un lieu d’hébergement et d’accueil, au sens social du terme.
Pourquoi pensez-vous qu’il est important de privilégier le milieu ordinaire au regard du milieu dit protégé ?
Le modèle psychiatrique actuel place systématiquement les patients dans des milieux protégés, que ce soient les hôpitaux à temps complet, les hôpitaux de jour, les Centres d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP), etc. Ce sont des espaces exposés au regard et à l’influence de soignants. Le principe sous-jacent de ce modèle est le pari qu’ils retourneront en milieu ordinaire lorsqu’ils seront prêts. En pratique, passer systématiquement par un milieu protégé aggrave bien souvent le problème. Car en tant que soignants, nous induisons un côté protecteur, nous créons sans même le vouloir un système à part, un cocon. Et plus nous sommes présents, plus les personnes risquent de perdre leur capacité d’adaptation. Cela nuit, en définitive, à la possibilité pour elles de mener des activités sociales en milieu ordinaire. C’est d’autant plus le cas pour les personnes très stigmatisées et auto-stigmatisées qui vont préférer rester protégées plutôt que de se confronter au regard des autres et aux problèmes de relations humaines et de stress. À la fin, cela conduit à les enfermer dans un carcan thérapeutique : les appartements, la danse, l’art, la musique, les animaux, tout devient thérapeutique.
Cependant, si, au lieu de leur proposer un cocon, nous les aidons tout de suite à évoluer dans leur environnement de vie, nous les rassurons sur leurs capacités, etc. Cela peut prendre, certes, plus de temps et un soutien intensif au début, mais cela peut éviter l’exclusion sociale. Je l’ai expérimenté à Marseille avec l’équipe LEAF (Leisure and activity first), une équipe d'accompagnement vers les loisirs en milieu ordinaire. Les activités n’y sont pas encadrées par des soignants, ni créées spécifiquement pour un public souffrant de troubles psychiques. Il s’agit, par exemple, de faire du sport ou de pratiquer du théâtre comme tout le monde et avec tout le monde, dans le réseau associatif ou communal. Et si une personne a besoin d’un refuge, d’une bulle, d’un « entre soi », les groupes d’entraide mutuelle (GEM) ou les milieux associatifs militants répondront mieux à ce besoin que les milieux protégés.
Quelle serait alors l’alternative à ce modèle centré sur l’hospitalisation et les milieux protégés ?
Il faut déjà considérer que les patients n’ont pas tous les mêmes besoins, certains demandent un suivi très régulier, d’autres traversent ponctuellement des états de crise, d’autres encore n’ont vécu qu’un seul épisode psychotique, etc. Il s’agit donc de développer un écosystème de soin et d’accompagnement qui puisse répondre à ces différents besoins, et que chaque personne, où qu’elle vive, puisse y avoir accès. D’après les recommandations internationales, il faudrait une équipe mobile de type « résolution de crise » en psychiatrie pour 150 000 habitants, associée au déploiement d’une offre de soins psychiatriques ambulatoires « classiques », d’équipes mobiles médico-sociales et d’autres dispositifs d’accompagnement en santé mentale.
Concernant les besoins purement médicaux, les équipes mobiles qui appliquent le modèle anglais de résolution de crise sont suffisamment réactives et intensives pour aider les personnes à traverser une crise sans être hospitalisés, si c’est leur souhait. J’ai pu l’expérimenter à Lille mais aussi à Marseille avec l’équipe ULICE (Unité locale d'intervention de crise et d'évaluation). C’est un modèle qui se rapproche d’une hospitalisation à domicile : visite de soignants plusieurs fois par semaine, aide à la prise de médicaments, etc. Cette alternative à l’hospitalisation a démontré son efficacité en termes de réduction des temps d’hospitalisation et d’augmentation de la satisfaction des patients. Les soins psychiatriques en ambulatoire classiques viennent compléter l’offre médicale en dehors des périodes de crises aiguës. L’hôpital, lui, comme je l’ai précisé plus tôt, répond plutôt à des cas très précis : surveillance 24h/24, plateaux techniques, consultations de spécialistes, recherche, etc.
Le volet médico-social accompagne les personnes dans leur parcours de vie. Le soin, ici, est mis au service du social. On y retrouve les structures qui s’adressent à des personnes en situation de perte d’autonomie, d’exclusion sociale et/ou de handicap psychique. Depuis cette année, nous menons une expérimentation d’équipe mobile pluridisciplinaire à Marseille avec le projet SIIS (Suivi intensif pour l’inclusion sociale). Il vise à réduire les temps d’hospitalisation de personnes très dépendantes de l’institution psychiatrique avec l’objectif de les réancrer dans un environnement de vie non centré sur le médical. Financé par le ministère de la Santé et porté par le Groupe SOS et la Coordination Marseillaise en Santé Mentale et Habitat, le projet déploie deux équipes sur deux territoires différents à Marseille et s’inspire d’une méthode américaine, mise au point dans les années 1980, dite « assertive community treatment » (suivi intensif dans le milieu). Il ne s’agit pas de déplacement en équipe à la manière d’une maraude pour créer du lien, prendre un café et s’enquérir de l’état de santé ou des besoins, mais de rendez-vous ponctuels pour avancer sur les objectifs précis préalablement déterminés avec la personne accompagnée : retrouver une vie sociale, du travail, un logement, etc. Pour y parvenir, la personne accompagnée a accès à un soutien et à une équipe à la carte, composée d’un coordinateur, de deux médiateurs en santé pair, de deux psychologues, de deux infirmiers, de deux psychiatres et de quatre travailleurs sociaux.
Ensuite, des dispositifs de type « Lieu de répit » apportent une réponse communautaire. Ce sont des lieux d’accueil et d’hébergement temporaire non médicalisés pensés pour des personnes traversant une crise psychique intense et ayant besoin de se mettre à distance de chez eux et d’être soutenus par d’autres personnes ayant vécu des expériences similaires, en association ou non avec l’offre de soins intensifs des équipes mobiles. Au quotidien, les GEM et les différents groupes entre pairs, comme le CoFor (Centre de formation au Rétablissement en santé mentale), les groupes d’entendeurs de voix ou des initiatives comme la Maison Perchée forment un filet de soutien et d’échange.
« Mettre le soin au service du social », est-ce, en résumé, votre philosophie du soin et l’accompagnement en santé mentale ?
Je pense, en effet, qu’il faut monter des équipes pluridisciplinaires qui ne soient pas sous l’autorité supérieure des psychiatres et s’appuyer sur le champ du médico-social pour mieux répondre aux besoins des personnes. En fait, les soins psychiatriques, même ambulatoires, devraient représenter un tout petit moment de la vie d’une personne en situation de fragilité psychique et non être centraux, comme c’est trop fréquemment le cas aujourd’hui. En tant que psychiatre, je dis à mes patients : vous n’avez pas besoin de moi sauf dans certains moments où je serai extrêmement disponible, par exemple si vous avez besoin en urgence de revoir votre traitement, si vous traversez une crise très aiguë et que vous n’êtes plus en capacité de prendre des décisions pour vous-même, etc. Les psychiatres, infirmiers en psychiatrie ainsi que les autres professionnels du soin intervenant en psychiatrie assurent la plupart du temps une fonction de soutien, d’accompagnement dans la vie quotidienne et dans le parcours de vie, alors que dans les autres domaines de la santé, ce sont les professionnels du champ du social qui assurent cette fonction ou à l’idéal l’entourage et les aidants naturels. En effet, dans le cas des personnes en fauteuil roulant, on ne demande pas l’avis du neurologue ou de l‘orthopédiste sur ce que la personne devrait faire ou non dans la vie. Cela devrait être la même chose en santé mentale. Trop souvent en psychiatrie, nous nous retrouvons confrontés à des questions plus sociales que médicales, pour lesquelles les médiateurs en santé pairs, les travailleurs sociaux et les psychologues pourraient être beaucoup plus utiles que nous. Certes, le handicap ou l’addiction peuvent nécessiter un regard soignant, mais il est beaucoup plus question d’exclusion sociale que de maladie. Je ne dis pas que les personnes ne sont pas malades, je dis juste que c’est essentiellement la société qui n’est pas inclusive, et ça, ce n’est pas du ressort des médecins.
La santé n’est pas une spécialité médicale, ce qu’a déjà acté l’Organisation mondiale de la santé en la définissant, non pas comme « l’absence de maladie ou d'infirmité », mais comme un « état de complet bien-être physique, mental et social ». Évidemment, les soignants contribuent à la bonne santé d’une personne, mais ils ne peuvent pas décider seuls de la manière de le faire, ni être les seuls légitimes à y contribuer. Le soin médical et les soignants doivent retrouver leur juste place. Dé-médicaliser la gouvernance est un point essentiel si nous voulons faire évoluer la façon dont la santé mentale est adressée en France. Le champ de la santé mentale ne devrait, en somme, ni être dirigé par des médecins, ni être centré sur les soins psychiatriques. C’est ce que nous expérimentons, au sein du projet SIIS, en veillant à ce qu’il n’y ait pas de hiérarchie entre les spécialités : les psychiatres n’y ont pas plus d’autorité que les travailleurs sociaux, les pair-aidants ou les psychologues.
Et quelle place donnez-vous aux patients et au rétablissement en santé mentale dans ce modèle alternatif de soin et d’accompagnement ?
Avec les équipes du projet SIIS, nous nous efforçons à mettre les personnes au centre de leur accompagnement, en veillant à ne pas parler à leur place et en nous concentrant sur l’utilité que nous pouvons avoir pour elles. C’est le principe des pratiques de soin et d’accompagnement orientées rétablissement. En tant que soignante, je perçois la psychiatrie et les traitements médicaux comme une ressource parmi d’autres dans les parcours de rétablissement des personnes. Soutenir leur rétablissement devrait être la finalité des politiques de santé publique. Cela dit, la démarche de rétablissement, en soi, appartient à chaque personne, il ne s’agit pas de tomber dans des formes d’injonction au rétablissement, ni dans des processus de formatage des parcours de rétablissement. En tant que psychiatre, je n’ai pas à dire à une personne qu’elle devrait faire de la musique ou de la sophrologie parce que ça lui fera du bien. Je peux, en revanche, lui donner un avis médical sur les bénéfices et risques de tel ou tel traitement, partager l’état des connaissances sur telle ou telle pathologie, etc. Il faut aussi avoir à l’esprit que le rétablissement est d’abord un combat contre la stigmatisation et l’exclusion sociale et pas seulement des compétences psychologiques à acquérir par les personnes, comme je l’entends de plus en plus dans les services de réhabilitation sociale. Il ne s’agit pas uniquement de les aider à vivre avec leur maladie, même si c’est un résultat très positif, mais de les aider à se sentir comme tout le monde, avec les mêmes droits que tout le monde, sans pour autant être normatif. J’ai pu constater que les projets et rêves des personnes que l’on accompagne sont la plupart du temps ancrés dans une certaine normalité : avoir un travail satisfaisant, un « chez-soi », des amis, etc. Cependant, dans un accompagnement orienté vers le rétablissement, on pourra tout à fait soutenir une personne dans des choix de vie plus marginaux, en s’assurant qu’il s’agit bien d’un choix personnel et non d’un choix restreint par la situation d’institutionnalisation ou d’exclusion sociale qu’elle subit.