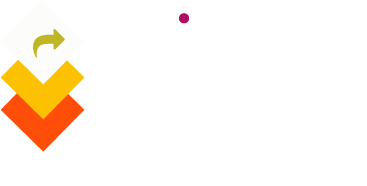La crise sanitaire rend le monde numérique presque incontournable, y compris pour les plus fragilisés. Dans cette perspective, l’exclusion numérique de près de 20% de la population française s’avère intenable. De nombreuses pistes, s’appuyant sur les outils ou l’accompagnement des pratiques, peuvent pourtant être explorées pour permettre au numérique, à défaut d’être habité par toutes et tous, de devenir habitable.
Le décret du 25 juillet 2019 sur l’accessibilité numérique contraint les sites Web à s’adapter aux différents types de handicap. Cette mesure difficilement imaginable il y a dix ans démontre qu’il n’y a pas de déterminisme technologique. Au beau milieu de cette période de crise sanitaire, propice aux changements, quels seraient les autres moyens de rendre le numérique pleinement accessible aux usagers les plus vulnérables ? De nos discussions avec des penseurs, des acteurs de la solidarité, de l’inclusion numérique, des communs ou des arts numériques, nous avons tiré douze idées fortes pour mettre les nouvelles technologies au service du « vivre ensemble » et de l’inclusion sociale. Histoire d’engager un dialogue et de stimuler nos imaginaires d’un « monde numérique » à réinventer…
1- Préserver la possibilité de se passer du numérique
Certains resteront toujours à distance du numérique, en raison de difficultés passagères ou durables, d’un handicap physique ou socio-culturel, mais aussi par choix personnel. Ainsi, bien que nécessaire pour beaucoup d’entre nous, le monde numérique ne doit pas devenir un passage obligé pour toutes et tous.
Le numérique n’est pas l’enjeu. L’enjeu, c’est la solidarité, avec ou sans numérique.
D’où la nécessité de préserver une médiation humaine de qualité, professionnelle ou bénévole, pour permettre à celles et ceux qui en ont besoin d’être accompagnés pour leur santé, les aides auxquelles ils ont droit, etc. C’est tout le sens des guichets de service public et des permanences dans les centres sociaux, ainsi que des médiateurs et aidants numériques qui accompagnent des personnes au quotidien dans leurs besoins d’utilisation des outils digitaux. Un cadre juridique sécurisé est de fait indispensable pour faciliter leur action. La plateforme Aidants Connect, testée depuis 2019, pourrait servir de modèle si son périmètre venait à s’élargir. Elle permet déjà à des médiateurs de réaliser des démarches administratives à la place d’une personne (impôts, assurance maladie, CAF, Pôle Emploi, etc.) sans accéder à ses identifiants et en gardant une trace des démarches en cas de litige.
2- Rester ancré dans le monde physique
« Une des grandes leçons du confinement reste que le numérique ne peut en aucune façon être dissocié du réel », observe Laura Mannelli, architecte, artiste et réalisatrice de ce qu’on appelle la Réalité étendue (XR), regroupant les différents dispositifs de réalités dites immersives. Si les casques de réalité virtuelle ont, en effet, pu faire miroiter l’idée d’une vie hors du monde réel, désarrimée du corps, incarnée par des avatars, l’habitation du numérique pendant le confinement nous a rappelé que le rapport physique et sensible au monde, lorsqu’il manque, provoque de la souffrance.
« Le numérique est un espace de socialisation révolutionnaire car il permet à quiconque de profiter d’une sociabilité choisie et non contrainte par l’endroit où l’on vit. Mais cela ne fonctionne que si on peut compenser les relations virtuelles par des contacts en présence. C’est ce que j’appelle high tech, high touch », explique Michel Bauwens, théoricien du « pair-à-pair ». Non seulement, la sociabilité en ligne inhibe les formes de communication informelle dont nous avons besoin pour entrer en relation, en empathie avec les autres, mais, en outre, son caractère choisi restreint a priori notre exposition à l’altérité, aux rencontres imprévisibles au-delà de nos cercles de vie habituels. Une habitation uniquement numérique conduirait donc à « étriquer nos vies », prévient le géographe Michel Lussault.
Concrètement, les acteurs de la solidarité, suite à l’expérience du confinement, ont compris l’intérêt du « distanciel » pour maintenir leurs actions auprès des personnes vulnérables, mais ils ont rapidement noté la nécessité d’organiser l’alternance entre échange à distance et échange en présence. Sans une articulation suffisante avec le monde physique, ils ont observé de nombreux décrochages, mais ils ont aussi perçu le risque d’une augmentation de pathologies comme la phobie du contact physique ou des troubles liés à l’isolement. « Les risques psycho sociaux du télétravail forment un champ d’études appelé à se développer », écrit la philosophe Joëlle Zacks.
3- Créer des sas de déconnexion
Articuler les espaces numérique et physique suppose un droit à la déconnexion, pouvant aller jusqu’à imposer des sas dans lesquels nous ne serions plus joignables par les moyens de communication à distance. « Quand on est connecté en permanence, on est en permanence dans l’immédiateté, aussi créer un sas de déconnexion signifie réinventer un temps à soi », explique Laura Mannelli. Michel Lussault perçoit quant à lui le sas comme une modulation de son rythme de vie : « temporiser, c’est modifier la relation à l’urgence, à l’immédiateté. Temporiser, c’est remettre de l’épaisseur dans la relation avec les autres, interroger le temps que l’on s’accorde et que l’on accorde aux autres ».
4- Faire vibrer la corde sensible du numérique
La qualité de la relation, indispensable à toute démarche de solidarité, nécessite une profondeur qui semble absente de nos « espaces » numériques, « par nature isoplanes, c’est-à-dire mettant tout et tout le monde sur le même plan, dit Michel Lussault. On peut mener des discussions interpersonnelles en chat pendant une visioconférence avec cinquante personnes ou couper sa caméra pour faire autre chose. Mais on fabrique de la profondeur en se soustrayant, ce qui reste peu satisfaisant. »
Laura Mannelli propose de s’inspirer des espaces de réalité virtuelle (sans casque) : en se déplaçant dans un espace donné, les avatars reproduisent artificiellement une notion de distance et un rapport au temps. La distance se recrée aussi d’un point de vue sonore : « On peut choisir de n’entendre que les avatars qui se trouvent proches de nous, pour filtrer et mieux concentrer notre attention ». Ce type de dispositif reconstitue un environnement et remet du relief dans les relations. Il pourrait permettre de mieux percevoir celles et ceux qui hésitent, s’éloignent du cœur de la discussion lorsqu’ils se sentent mal à l’aise. Son enjeu serait par exemple d’attirer notre attention sur des personnes en décrochage ou exclues d’un collectif et qui pourraient avoir besoin d’être accompagnées. On pourrait également mettre à profit les recherches en intelligence artificielle sur la détection et la représentation des émotions, ou les recherches linguistiques numériques, dont celles sur la pratique des émôticones, des mèmes, etc. Designer des outils numériques pour rendre l’expérience de coprésence plus proche du réel, pour y exprimer notre rapport sensible aux autres et au monde, pourrait nous aider à mieux vivre les dispositifs de télémédecine, de télétravail, de cours à distance, etc.
5- Construire un environnement numérique habitable par tous
« Il existe dans le monde numérique, une dictature des gens agiles qui poussent à la nouveauté permanente. Si elle est vécue comme une liberté par ceux-là, cette instabilité technologique engendre pour les autres beaucoup de surcharge cognitive et favorise des situations de burn-out. Nous avons besoin de retrouver une certaine frugalité numérique », estime Denis Pansu, expert en usages numériques à la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING). Pour beaucoup, notamment les personnes âgées, les personnes en situation de handicap visuel ou d’illettrisme, apprendre à se servir d’une nouvelle interface peut provoquer de la souffrance et, dans certains cas, un sentiment d’obsolescence, de déclassement.
Denis Pansu défend l’idée de stabiliser les outils et les protocoles, en commençant par mieux exploiter les possibilités actuelles, déjà conséquentes. Dans la majorité des cas, « il faut être expert pour pouvoir simplifier l’interface d’un outil numérique, c’est absurde », déplore-t-il. Ainsi, plutôt que de surcharger les outils de fonctions et de pictogrammes, l’idée serait de débuter avec une version basique, puis, au fil de l’apprentissage, de choisir d’ajouter de nouvelles fonctions. Il cite, à ce propos, le projet Open Office Kids qui met l’accent sur les fonctionnalités les plus courantes ou encore Ordissimo, un fabricant d’ordinateurs accessibles, qui a par exemple ajouté sur les claviers une touche « copier » et une touche « coller ».
6- Avoir des codeurs de toutes les couleurs et de tous les genres
« Aujourd’hui, la tech reste faite par des hommes blancs surdiplômés, donc les services ont tendance à être pensés pour des hommes blancs surdiplômés », constate Caroline Span, co-directrice de la Mednum. En formant au code des migrants, des femmes ou des personnes issues de quartiers populaires, les structures comme Simplon, Social Builder, le réseau Grande école du numérique, l’école 42, etc., transforment peu à peu ce visage de la « tech », mais de façon encore trop marginale.
De fait, ces nouveaux publics de la formation au numérique introduisent des problématiques jusqu’alors trop peu considérées. La pensée cyberféministe, par exemple, traque les violences de genre, le sexisme, le racisme, et propose d’autres esthétiques que celles standardisées par les grandes entreprises technologiques. « Il n’y a pas d’Internet, il n’y a que des internets possibles », clame ainsi le collectif britannique Feminist Internet, qui a conçu une application de recherche et de conversation qui aide à appréhender les biais dans les programmes d’intelligence artificielle, ainsi qu’une Alexa féministe pour dénoncer l’attribution d’un genre féminin à l’enceinte intelligente d’Amazon. Donner un genre à des machines est une pratique qui alarme également l’UNESCO en raison de l’instrumentalisation du genre et de son effet sur le renforcement des préjugés sexistes.
7- Inventer et développer des métiers du care et du lien numériques
Apprendre à utiliser « techniquement » un outil s’avère souvent très insuffisant. Un outil peut être collaboratif, au sens où il permet de travailler à plusieurs en même temps sur un même document, mais il n’est pas « collaborant », au sens où son existence ne suffit pas à nous faire travailler ensemble. Autre exemple : certaines personnes en situation d’illettrisme savent se servir de la dictée vocale de leur smartphone pour communiquer par écrit et compensent ainsi leur handicap social, mais l’outil ne leur apprend pas à écrire, donc à s’émanciper durablement. Par un effet pervers, ces personnes deviennent très dépendantes de leur téléphone.
Denis Pansu préconise dès lors d’étoffer la médiation numérique de nouveaux rôles de sorte à « repeupler les outils d’humains ». Par exemple, inventer le métier de « synthétiseur » afin de rendre les débats intelligibles pour les autres.
Michel Bauwens, fondateur de la P2P Fondation, imagine quant à lui des « cybothécaires ». Un peu comme un bibliothécaire, un cybothécaire garderait la mémoire des échanges d’un groupe, les rendrait accessibles à toutes et tous, en conseillant certaines lectures, avec une attention particulière envers les personnes les plus en difficultés. Il serait aussi le témoin de l’histoire de ce groupe, il serait, en somme, le dépositaire de sa raison d’être. Ainsi, quels qu’ils soient, les métiers numériques de demain ne pourront pas être uniquement technologiques, loin s’en faut : nous avons besoin d’inventer et de développer des métiers du care et du lien dans le numérique.
8- Mieux identifier les vulnérabilités liées au numérique
Qui sont les 13 millions de personnes qui seraient selon les chiffres officiels éloignées du numérique ? Quelles sont leurs difficultés ? Où peuvent-elles se faire aider ? Il existe des baromètres, des référentiels de compétences numériques, une cartographie des lieux d’accompagnement au numérique, mais aucun outil ne permet encore de « localiser » ces 13 millions de personnes. Il ne s’agirait évidemment pas de les pister individuellement, mais d’identifier des zones géographiques nécessitant une attention plus forte, des moyens spécifiques. C’est l’idée de « l’indice de fragilité numérique ». Expérimenté dans une dizaine de collectivités par l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives (ANSA) et la Mednum, coopérative nationale des acteurs de la médiation numérique, il vise à cartographier les zones d’exclusion numérique et à les suivre dans le temps pour aider les politiques territoriales et les actions associatives ou entrepreneuriales à mieux cibler géographiquement leurs actions et mesurer leurs impacts.
9- Renforcer l’économie numérique sociale et solidaire
On dénombre déjà beaucoup d’initiatives numériques solidaires. Transiscope cartographie les projets œuvrant pour une transition écologique et sociale. Le moteur de recherche Lilo mobilise les recettes publicitaires générées par les requêtes de recherche pour financer des projets environnementaux, solidaires ou défendant la cause animale. LinkedOut, lancé par l’association Entourage, permet de partager des CV de personnes exclues auprès de son propre réseau professionnel. Utopia Maker organise une banque de temps en ligne pour faciliter l’entraide de personne à personne. Le réseau Tech For Good rassemble des acteurs et des investisseurs qui développent des solutions technologiques dans l’intérêt commun. On y trouve par exemple : Konexio qui forme les réfugiés au numérique ; MyTroc.fr, une plateforme de don et de troc en ligne ; Comerso, une plateforme qui récupère les invendus et les distribue aux associations locales ; ou encore La Nef, une banque qui finance des actions à impact social et environnemental.
Les réseaux se structurent, mais nous pourrions aller plus loin, et donner corps à cette autre économie numérique via un espace en ligne cohérent et très identifiable. On pourrait lui donner une existence statutaire qui prenne en compte la spécificité du numérique, par exemple des conditions de financements favorables sous réserve d’une non exploitation commerciale des données. Cette démarche juridique et organisationnelle se retrouve aujourd’hui dans le mouvement des communs. S’articulant autour d’une ressource que partage et préserve une communauté selon des règles acceptées et établies par toutes et tous, les communs proposent un modèle en accord avec les valeurs des organisations solidaires. CoopCycle, fédération de coopératives de livreurs à vélo, mutualise par exemple un outil de gestion logistique et permet à des livreurs de s’émanciper d’entreprises comme Uber ou Deliveroo qui produisent de la précarité économique. Les tiers-lieux solidaires et citoyens, à l’image des Grands Voisins, sont une autre forme de communs, cette fois-ci non numérique.
En somme, les acteurs de l’économie des communs réfléchissent à des manières de produire des outils collectivement pour mieux partager les connaissances et la valeur produites. Afin de répartir les pouvoirs d’agir, ils « éclatent » la propriété privée en plusieurs faisceaux de propriété dépendants les uns des autres : droits de cession, droits d’exploitation, droits de gestions, etc. Ce que produit le mouvement des communs, dont les communs numériques forment l’élément moteur, c’est d’abord une révolution juridique, c’est-à-dire des fondements institutionnels d’une autre façon de vivre ensemble.
10- Transformer le monde numérique en espace de construction d’un vivre ensemble
Le monde numérique a développé un espace public opéré par des entreprises privées : Twitter, Facebook, YouTube, etc. Ce qui explique les critiques vis-à-vis du « vivre ensemble » que celles-ci bâtissent de fait. Cet espace public numérique est en effet façonné par des bulles de filtres, organisant in fine la sphère publique selon la logique d’un « entre soi ». Il en résulte un espace public ne jouant plus son rôle de confrontation à l’autre, alors même que la solidarité se construit dans l’exposition à l’altérité comme le souligne Michel Lussault. En effet, les algorithmes des réseaux sociaux, en nous mettant sous les yeux les contenus produits par nos proches ou par ceux avec lesquels nous partageons des intérêts communs, séparent plus qu’ils ne rassemblent, renforçant chacun dans ses propres convictions, qu’aucune parole ou presque ne vient contredire. Nous ne rencontrons donc pas ceux qui vivent, pensent différemment… et pourraient peut-être troubler nos a priori et certaines certitudes réductrices.
Comment contrebalancer cet effet de myopie, et ainsi éviter que l’altérité soit uniquement vécue comme un affrontement ? Comme évoqué, il faudrait déjà retrouver dans le numérique une forme de profondeur, percevoir au loin ceux auxquels on prête d’habitude moins d’attention, comme l’arrière-plan un peu flou dans lequel le premier plan s’insère. Cela rendrait « l’Autre » visible. Rendre visible, c’est une condition sine qua non de l’expression de toute solidarité. Quand le confinement a vidé les rues des passants, les personnes vivant dans la rue sont devenues soudain très visibles, provoquant un large élan de solidarité…
11- Créer des espaces de « dispute numérique » afin d’assumer nos différences et de mieux construire notre « vivre ensemble »
Selon le géographe Michel Lussault, l’espace numérique serait propice au débat contradictoire. Il est en effet plus facile, selon lui, de se confronter à distance qu’en présence physique avec des personnes qui pensent autrement que nous : « L’absence du corps devient un avantage, on n’est pas dans le même régime d'offense que quand le corps est présent. Il y a moins d’enjeu à distance qu’en face à face. Le numérique pourrait alors permettre des débats plus disputés, plus dissensuels, plus dans la mésentente. Le numérique pourrait nous aider à reconstituer du différend, qui ne serait pas communautaire, mais un différend discuté et discutable. Nous pourrions ainsi imaginer des dispositifs de dispute numérique ».
Mais comment transformer les réseaux sociaux que nous connaissons en espaces de « dispute numérique » à des fins de construction du débat public ? On pourrait, pourquoi pas, les doter d’une mission de service public, à l’image des entreprises de transport, de presse ou de communication. Dans le même ordre d’idée, le juriste Lionel Maurel réfléchit à des logiciels à mission en s’inspirant du modèle des entreprises à mission — des entreprises privées qui, en plus de leur but lucratif, se dotent d’une finalité d’ordre social ou environnemental, qui devient théoriquement opposable à son obligation de profit vis-à-vis de ses actionnaires. Le bénéfice social d’un outil ou d’un service numérique deviendrait alors statutairement aussi important que le bénéfice économique. Et si, finalement, les milliards d’utilisateurs de ces réseaux sociaux mondialisés se mobilisaient afin d’en faire des communs numériques ?
12- Penser un monde numérique solidaire ET écologiquement soutenable
Enfin, considéré comme un sixième continent, le numérique doit reconnaître sa « matérialité ». Derrière ce qu’on appelle le « cloud » qui facilite l’accès aux contenus numériques, il y a un nombre inimaginable d’ordinateurs et de serveurs. Derrière un clic sur Amazon, il y a un camion qui livre. Les technologies numériques consomment aujourd’hui autant d’énergie que le trafic aérien, avec une augmentation de 12% par an. « Il faut prendre conscience que le numérique est une industrie comme une autre. Elle consomme de l’énergie et permet aussi peu de recyclage que les autres industries. En plus, le numérique est extrêmement sensible aux effets rebonds. L’amélioration des technologies et de leur efficacité provoque, à chaque fois, une augmentation des usages », explique Renaud Francou, auteur de L’agenda pour un futur numérique et écologique. Selon lui, il faut commencer par allonger la durée de vie de nos appareils connectés, c’est par exemple le pari des Fairphones. Ces téléphones sont conçus pour être réparés facilement par chacun, et ils contiennent jusqu'à 40 % de plastiques recyclés.
Malheureusement, nous faisons face à des politiques d’innovation qui cherchent la performance sans donner de place sérieuse aux questions écologiques. Il en est par exemple ainsi de l’intelligence artificielle. On y observe une course à la puissance de calcul, donc aux dépenses énergétiques, qui se matérialise par un nombre toujours plus grand de couches de réseaux neuronaux. « La quantité d'énergie requise pour l’entraînement et les requêtes d’une architecture d’IA par réseaux de neurones peut émettre jusqu’à 280 tonnes de dioxyde de carbone, ce qui correspond aux émissions d’une voiture américaine pendant toute sa vie, de sa production à sa destruction », rapportent des chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology) de Boston. Ces derniers expliquent avoir mis au point un système qui serait capable de diviser par mille les émissions de carbone des réseaux de neurones actuels. Ainsi, poser comme préalable à tout développement technologique de se soucier de son empreinte carbone et environnementale en général, semble non seulement compatible avec la recherche de performance mais pragmatique… et indispensable dans une logique de solidarité vis-à-vis des générations à venir. Pourquoi, en effet, développer et investir dans une technologie qu’on ne pourra plus utiliser dans dix ou quinze ans, car elle ne correspondra sans doute pas aux normes environnementales en vigueur ?
En définitive, construire un monde numérique non pas habité mais habitable par tous…
Rêvons un peu. En résumé, un monde numérique solidaire serait un monde, non pas habité, mais habitable par tous. Ce serait un monde qui ne se satisferait pas de voir les plus démunis privés des avancées et de l’émancipation permises par les outils numériques, mais qui reconnaîtrait que le numérique ne pourra jamais tout régler. Ce serait aussi un monde qui réfléchirait à l’utilité des technologies nouvelles au lieu de les adopter sous la pression du marché. En interaction continue avec le monde physique, il serait écologiquement soutenable, éviterait une trop forte déshumanisation et trouverait des moyens pour que nous puissions mieux y exprimer nos émotions, la profondeur de nos échanges. Ce monde numérique serait rendu possible par le renforcement d’une économie numérique sociale et solidaire qui favoriserait la production de communs numériques.
Rêvons encore. Et si nous faisions évoluer les priorités d’investissement public, mais aussi privé ? Plutôt que de privilégier et d’encourager le financement d’infrastructures et de champions de la tech, pourquoi ne pas investir dans la capacité du numérique à répondre aux besoins d’éducation et de solidarité, voire à l’élaboration d’une pensée citoyenne, critique à propos et au-delà même du numérique ? Et si pour éviter cette fascination aveuglante pour la technologie, nous considérions le numérique comme l’un des « ensemble » du « vivre ensemble », comme un instrument à mettre au service de toutes et tous pour enrichir nos espaces communs de vie, fussent-ils sans numérique ?