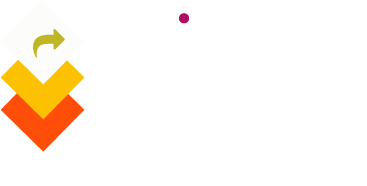« Décloisonner le soin et l’accompagnement, un modèle d’avenir ? » : tel est l’intitulé de la grande table-ronde ouverte des Rencontres solidaires de la Fondation Cognacq-Jay, le 31 mars 2023 au 104-Paris. La discussion qui suit prépare en quelque sorte le terrain de cet événement. Elle débute par une introduction autant historique que d’actualité de Jean-Luc Fidel, Directeur général de la Fondation Cognacq-Jay, avant d’être enrichie des points de vue de Giorgia Ceriani Sebregondi, directrice de son Laboratoire des Solidarités, d’Olivier Frezet, directeur du dispositif DomCare Aidance, Dépendance, Autonomie de la Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle, et de Sabra Ben Ali, psychologue clinicienne et doctorante qui a mené une expérimentation pour « faire venir l’extérieur à l’intérieur » d’un Institut thérapeutique éducatif et pédagogique.
Ariel Kyrou : L’intitulé des Rencontres solidaires du 31 mars 2023 est : « Décloisonner le soin et l’accompagnement, un modèle d’avenir ? ». Quel sens donneriez-vous à cette notion de décloisonnement ?
Jean-Luc Fidel : Décloisonner présuppose d’avoir des murs, et désigne l’objectif de faire tomber ces murs ou du moins certains d’entre eux. Le point de départ, historiquement, c’est donc le cloisonnement. Les opérateurs du soin et de l’accompagnement se sont en effet spécialisés à partir d’une activité initiale qu’ils ont fondée. Puis ils ont profité de filières de financement elles-mêmes très spécifiques, nécessitant d’entrer dans des cases, pouvant dépendre là de l’Assurance maladie, ici d’autres services de l’État, des départements ou de collectivités locales, etc. Dans un pays comme le nôtre, avec ses multiples strates administratives, les opérateurs de solidarité – publics ou privés – se sont structurellement spécialisés dans un domaine précis et pas un autre. Notre système de la solidarité entier s’est élaboré selon cette logique, pour rentrer dans des silos de financements, des silos d’activité, des silos d’expertise et de compétences sur des territoires donnés. Toute notre démarche de développement des services a eu tendance à mettre les « sujets de la solidarité » – les bénéficiaires – dans des catégories.
Ariel Kyrou : Et c’est cela qui ne fonctionne plus ?
Jean-Luc Fidel : Aujourd’hui, les acteurs se rendent compte des limites de ce système, de la nécessité de ne plus raisonner en silos, en spécialités, mais en termes de parcours des personnes. Cette prise de conscience tient au vieillissement de la population, à l’émergence des maladies chroniques, au dépistage précoce de certaines maladies et handicaps, aux évolutions du diagnostic de l’autisme par exemple…
Ariel Kyrou : Mais n’y a-t-il pas d’autres explications historiques à ce cloisonnement ?
Jean-Luc Fidel : Il y a en une deuxième : en particulier au XXe siècle, les opérateurs du sanitaire, du social et du médico-social ont inscrit leur action dans du bâti, souvent en périphérie des villes, autour de « l’hébergement » des personnes. Or cet hébergement, justifié par une nécessité de protection des personnes résidentes comme à l’inverse à l’extérieur des établissements, masquait un enfermement ou du moins une mise à l’écart de la société. Depuis une vingtaine d’années, la tendance est tout au contraire de réduire ce temps de mise à l’écart, « hors société », de la personne.
J’ajouterais enfin une troisième explication au cloisonnement, d’une nature différente, très humaine : pour un opérateur, il est beaucoup plus facile de croître sur un socle de légitimité, sur une aura d’expertise déjà acquise, donc sur des services et des modèles de fonctionnement éprouvés, et ainsi de reproduire ce que vous savez faire.
Ariel Kyrou : Ce constat est-il juste, aussi, pour la Fondation Cognacq-Jay ?
Jean-Luc Fidel : Pour la Fondation Cognacq-Jay, multi-spécialiste par vocation, questionner « le décloisonnement » a un sens particulier. Car sa singularité est de ne pas se dédier à une connaissance experte dans un domaine donné, mais de privilégier l’agilité face à l’émergence de problématiques nouvelles, en partant des personnes et non d’une spécialité, donc des parcours des personnes. Notre attention se porte sur les priorités sociales, sanitaires ou médico-sociales de l’époque, pas sur le développement de savoir-faire et de prises en charges qui jamais ne changeraient. En témoigne la façon dont la Fondation et ses établissements ont appréhendé le développement des soins palliatifs il y a 40 ans, ou dont nous avons répondu – parmi les premiers opérateurs – à la pandémie du VIH. L’idée est simple : répondre aux besoins nouveaux, ce qui nécessite de raisonner globalement, en termes de parcours de vie.
Ariel Kyrou : Soit une logique, de l’ordre du décloisonnement, qui rejoint la dynamique d’évolution actuelle de tous les établissements de soin et d’accompagnement ?
Jean-Luc Fidel : Certes, mais la réalité d’un opérateur gérant une cinquantaine d’EHPAD n’est pas la même que celle d’une fondation comme la nôtre, avec moins de structures, qui plus est autonomes et aux domaines divers, du soin hospitalier à l’accompagnement de personnes en situation de fragilité psychique, avec aussi un IME, un EHPAD, un lycée professionnel, etc. Ce qui est en revanche propre à l’ensemble des secteurs de la santé et du médico-social, c’est que nous avons de plus en plus d’actions au domicile et de flux dans nos établissements, avec des personnes ne venant que pour des durées limitées. Il y a, quoi qu’il en soit, une nécessité pour tous les opérateurs d’aller vers une forme de décloisonnement, qui se traduit en deux mouvements : d’une part ouvrir les lieux, d’autre part sortir des structures. Créer des entités nouvelles pour gérer des réseaux et faciliter des liens entre établissements ne communiquant pas ou pour gérer le passage entre établissements et prises en charge à domicile n’est pas une réponse suffisante… Je pense en effet qu’on ne peut décloisonner avec une structure pyramidale, verticale. Le décloisonnement et le travail en partenariat supposent d’avoir des structures internes les plus horizontales possibles. Le décloisonnement est aussi le fruit d’un état d’esprit, d’une culture partagée et d’une volonté managériale.
Olivier Frezet : L’objectif de décloisonnement figurait dès les années 1980 dans des circulaires des secteurs de la santé et du médico-social… Au début de ma carrière professionnelle, je voulais casser leurs silos. Aujourd’hui, je serais plus mesuré. Je suis d’accord avec le cœur de l’analyse de Jean-Luc Fidel, notamment sur la nécessité de partir de la personne. Je pense en revanche qu’il est possible de maintenir les silos, qui la plupart du temps remplissent leurs fonctions, tout en les faisant évoluer et en les connectant grâce à des passerelles. L’enjeu n’est pas, pour reprendre des expressions à la mode, « l’EHPAD hors les murs », « l’EHPAD à la maison » ou « le virage domiciliaire », mais l’accompagnement des personnes âgées – comme d’ailleurs de leurs aidants – pour les orienter et les soutenir dans leur parcours de vie, depuis chez eux jusqu’à tel ou tel type d’établissement si nécessaire. C’est tout le sens du dispositif DomCare Aidance, Dépendance, Autonomie de la Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle, que je pilote. Grâce à deux équipes mobiles, l’une d’Urgence Nuit et l’autre de Soutien aux Aidants à Domicile, ce service de soins infirmiers intervient chez les personnes âgées ou en situation de handicap. Ce type de dispositif très neuf sert justement de passerelle entre le domicile, les centres de santé, les EHPAD aussi, etc., car il permet d’anticiper les situations d’aidance et les ruptures de parcours de vie.
Giorgia Ceriani Sebregondi : Il n’y a pas si longtemps, tout devait passer par les « établissements », et j’ai le sentiment que le « à domicile » devient en quelque sorte un nouveau mantra, remplaçant le précédent. Les situations ne sont-elles pas plus complexes ? Rester à domicile devrait-il devenir maintenant une finalité absolue ? Je n’en suis pas si certaine…
Olivier Frezet : C’est bien pourquoi je parle de soutien à domicile et pas de maintien à domicile. Nous ne maintenons pas, nous essayons d’accompagner les parcours de vie, en écoutant les personnes âgées comme leurs aidants, à partir de la maison car c’est tout simplement le lieu où elles habitent, y passant bien plus de temps qu’à l’hôpital ou que dans quelque autre établissement… Tout doit rester ouvert.
Jean-Luc Fidel : Sur un registre proche, puisqu’on parle de la maison, le numérique permet aujourd’hui de préparer les interventions, de cultiver le lien avec les patients lorsqu’ils quittent l’hôpital et les équipes qui les ont soignés, de les accompagner sur le moyen et le long terme pour leurs soins grâce à des questionnaires sur leurs douleurs, leurs symptômes, mais aussi quand cela est nécessaire de créer les conditions d’une nouvelle relation directe. Il est important d’intégrer le flux numérique dans une chaîne de valeurs et de services. Ce ne doit plus être un maillon, mais une dimension nouvelle : nous n’accompagnons pas des organes ou même des malades, mais des personnes, avec la présence de plus en plus forte de leur environnement familial, affectif, des enfants aux aidants… Tout cela exige la mise en place d’outils nouveaux. Mais ce n’est qu’une dimension parmi d’autres de cette notion de décloisonnement…
Sabra Ben Ali : Le décloisonnement tel que je le pratique me semble d’un autre ordre : il renvoie à la citoyenneté et à la façon dont des établissements, fermés de par leur mission, s’ouvrent à « leur extérieur ». Je suis chargée de recherche pour une association médico-sociale, l’OREAG, qui accompagne 2000 jeunes en Gironde dans les champs de la protection de l’enfance, de la protection judiciaire et du handicap psychique. Dans ce cadre, j’ai lancé une démarche de recherche-action pour laquelle nous avons créé une association qui s’appelle La Petite Sœur. Il s’avère très compliqué d’ouvrir vers l’extérieur les établissements dont s'occupent les associations gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux, alors même qu’il est essentiel de préparer les jeunes et la société au moment où ces jeunes citoyens devront sortir des espaces de prises en charges. L’enjeu de La Petite Sœur est dès lors de faire entrer « l’extérieur » à l’intérieur des établissements. Sa première action a été de profiter de 400 m2 non affectés au sein de l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) Louise Liard Le Porz au cœur de Bordeaux. Nous avons mis cet espace à disposition de collectifs associatifs ou artistiques, qui, pendant un an, se sont adaptés à ce milieu spécifique, se sont rendus disponibles, au quotidien, à la rencontre avec ses jeunes. Âgés de 6 à 21 ans, ceux-ci ont très bien vécu cette cohabitation. Ils ont apprécié le regard bienveillant d’adultes ne faisant pas partie du personnel, qui ne leur demandaient rien, si ce n’est de partager avec eux des moments comme dans un village. L’image de l’établissement dans la cité a lui aussi changé, car nous avons organisé une ouverture publique mensuelle de ce lieu qui reste habituellement fermé. Et aujourd’hui, nous poursuivons notre démarche au sein d’un centre éducatif fermé.
Olivier Frezet : C’est bien pourquoi je parle de soutien à domicile et pas de maintien à domicile. Nous ne maintenons pas, nous essayons d’accompagner les parcours de vie, en écoutant les personnes âgées comme leurs aidants, à partir de la maison car c’est tout simplement le lieu où elles habitent, y passant bien plus de temps qu’à l’hôpital ou que dans quelque autre établissement… Tout doit rester ouvert.
Jean-Luc Fidel : Sur un registre proche, puisqu’on parle de la maison, le numérique permet aujourd’hui de préparer les interventions, de cultiver le lien avec les patients lorsqu’ils quittent l’hôpital et les équipes qui les ont soignés, de les accompagner sur le moyen et le long terme pour leurs soins grâce à des questionnaires sur leurs douleurs, leurs symptômes, mais aussi quand cela est nécessaire de créer les conditions d’une nouvelle relation directe. Il est important d’intégrer le flux numérique dans une chaîne de valeurs et de services. Ce ne doit plus être un maillon, mais une dimension nouvelle : nous n’accompagnons pas des organes ou même des malades, mais des personnes, avec la présence de plus en plus forte de leur environnement familial, affectif, des enfants aux aidants… Tout cela exige la mise en place d’outils nouveaux. Mais ce n’est qu’une dimension parmi d’autres de cette notion de décloisonnement…
Sabra Ben Ali : Le décloisonnement tel que je le pratique me semble d’un autre ordre : il renvoie à la citoyenneté et à la façon dont des établissements, fermés de par leur mission, s’ouvrent à « leur extérieur ». Je suis chargée de recherche pour une association médico-sociale, l’OREAG, qui accompagne 2000 jeunes en Gironde dans les champs de la protection de l’enfance, de la protection judiciaire et du handicap psychique. Dans ce cadre, j’ai lancé une démarche de recherche-action pour laquelle nous avons créé une association qui s’appelle La Petite Sœur. Il s’avère très compliqué d’ouvrir vers l’extérieur les établissements dont s'occupent les associations gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux, alors même qu’il est essentiel de préparer les jeunes et la société au moment où ces jeunes citoyens devront sortir des espaces de prises en charges. L’enjeu de La Petite Sœur est dès lors de faire entrer « l’extérieur » à l’intérieur des établissements. Sa première action a été de profiter de 400 m2 non affectés au sein de l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) Louise Liard Le Porz au cœur de Bordeaux. Nous avons mis cet espace à disposition de collectifs associatifs ou artistiques, qui, pendant un an, se sont adaptés à ce milieu spécifique, se sont rendus disponibles, au quotidien, à la rencontre avec ses jeunes. Âgés de 6 à 21 ans, ceux-ci ont très bien vécu cette cohabitation. Ils ont apprécié le regard bienveillant d’adultes ne faisant pas partie du personnel, qui ne leur demandaient rien, si ce n’est de partager avec eux des moments comme dans un village. L’image de l’établissement dans la cité a lui aussi changé, car nous avons organisé une ouverture publique mensuelle de ce lieu qui reste habituellement fermé. Et aujourd’hui, nous poursuivons notre démarche au sein d’un centre éducatif fermé.
Giorgia Ceriani Sebregondi : Ce type de structures pour la jeunesse doit évoluer et s’ouvrir tout en préservant une centralité, un cocon… Il ne faut pas oublier, en effet, que la fermeture n’est pas que négative, elle intègre également une notion de protection. Comment avez-vous fait pour la préserver ?
Sabra Ben Ali : D’abord, nous avons eu la chance de bénéficier d’espaces suffisamment séparés de l’ensemble de l’Institut, ce qui a permis d’éviter le côté intrusif de toute cohabitation forcée. Pour aller dans cet espace, dont nous avons transformé l’esthétique et que nous avons appelé La Rêverie, il fallait le vouloir. Il était marqué, repéré en tant que tel par nos publics. Ensuite, il avait ses propres codes, sachant que ses collectifs ont été choisis pour leur capacité à faire face et à tisser des relations avec des jeunes dont l’accès n’est pas facile. Les professionnels ont d’ailleurs remarqué que les jeunes s’y présentaient comme à l’extérieur. Ils disposaient, grâce à ce pas de côté, d’une possibilité d’échapper au regard associé à leur handicap au sein de la structure, et d’un lieu où souffler, voire gérer des moments de crise, tel une soupape : « Là, je vais à La Rêverie… » À côté de lieux de soin identifiés, il s’agissait d’un espace de respiration, où être entouré d’autres personnes que des psys, pour faire de la photo, de la céramique, ou juste s’asseoir et discuter. L’équipe s’est également saisi de cette extériorité : pour prendre un café ou un thé avec un jeune, soit un moment difficilement possible car contraint en termes d’autorisation et d’accompagnement dans le cadre d’une sortie hors de l’établissement. Enfin, les jeunes ont été touchés que des adultes aient envie de vivre avec eux : ils sont venus les remercier à la fin de l’expérience.
Ariel Kyrou : Décloisonner pourrait-il devenir un impératif ? Une obligation ?
Sabra Ben Ali : L’ouverture ne peut pas se décréter, car même s’il n’y pas de mur physique, d’autres murs peuvent se créer dans l’interaction, dans la perception de l’autre et de sa manière d’exister. On peut parfaitement être hermétique à la relation et remettre des murs mentaux en l’absence de murs physiques.
Jean-Luc Fidel : Oui, le décloisonnement ne se décrète pas. La question « cloisonnement versus décloisonnement » me semble d’abord une image mentale, une représentation de la société. Les murs sont dans nos cerveaux. Il existe des cloisonnements, des échelles de valeur la plupart du temps non dites mais actives entre différents types de secteurs, d’opérateurs, d’établissements, et même de professionnels de la santé et du médico-social. Ensuite, bien sûr, il y a les cloisonnements entre ces mondes de la santé et du médico-social et d’autres mondes, comme ceux des arts ou de l’éducation. L’enjeu de faire venir des artistes dans des établissements, et plus largement de décloisonner les lieux eux-mêmes du reste de la société pour minimiser les ruptures, évoqué par Sabra, est très présent au sein des EHPAD dans le champ de l’enfance et de la jeunesse. Le « qui fait quoi » est une troisième dimension de la problématique : un lieu ne doit pas être fermé sur un seul et même type d’intervenants. Il faut réussir à donner une place à chacun. Les personnes ne sont pas que des sujets de soin dans un protocole avec des spécialistes. Bénévoles, aidants, familles, etc. : les acteurs gagnent à travailler ensemble, échanger des informations, au profit de l’accompagnement global de la personne. Enfin, un dernier point : les territoires. Personne ne décloisonne dans l’abstrait, on décloisonne dans un espace physique, concret : les réalités territoriales pèsent. Comme le disait Leroy Ladurie : « la France, pays de pays ». Notre pays est un assemblage de régions très différentes de par leur histoire, leur géographie, leur climat, leur densité de population… Or la puissance publique plaque encore trop souvent ses dispositifs sans différenciation sur tous les territoires. L’injonction de développer des soins palliatifs sur l’ensemble des territoires, par exemple, ne marche pas si l’on n’intègre pas les disparités de territoires et de problématiques : les ressources médicales à Guéret dans la Creuse ne sont évidemment pas les mêmes qu’à Paris. À cet égard, la France souffre d’un handicap pour bien développer des services de proximité : trop de communes, trop petites, donc très limitées en ressources.
Giorgia Ceriani Sebregondi : Effectivement, le décloisonnement ne peut se concrétiser partout de la même manière. Mais la question, elle, se pose partout, ce qui implique d’assumer et de généraliser l’objectif de décloisonnement dans tous les appels à projet ou demandes des tutelles. Sans nécessité d’injonction, l’enjeu est de créer une ligne de mire vers laquelle tendre pour nos espaces mentaux, afin d’impulser des changements de pratiques, d’apprendre les uns des autres et d’encourager les fertilisations croisées.
Ariel Kyrou : Et si, à l’inverse, les autorités nous interdisaient toute expérimentation de décloisonnement, quelles pourraient être les conséquences ?
Olivier Frezet : Ce serait très dangereux. Car entrer dans la dépendance, c’est comme entrer dans un « troisième monde ». Cela suppose un accompagnement, autant pour les aidants que pour personnes très âgées ou en situation de handicap. Privés d’un travail d’information et plus largement de « reliance », les gens ne pourraient s’approprier les codes de ce troisième monde.
Sabra Ben Ali : Ce serait une régression, un retour au fonctionnement asilaire, à l’entre-soi, à la paranoïa. Les professionnels perdraient toute fonction sociale et cela sonnerait à mes yeux l’entrée en dystopie.
Jean-Luc Fidel : Ni le cloisonnement ni le décloisonnement ne se décrètent. Dès lors que le décloisonnement est un état d’esprit et qu’il reste primordial de prendre en compte les contraintes propres à chaque situation, accorder une part importante aux initiatives personnelles devient crucial. Vous ne pouvez imposer à un chef de service, qui a construit ses réseaux de confiance et de pratiques, de changer de partenaires du jour au lendemain. En revanche, là où le modèle du contrôle et de la surveillance incite au repli sur soi et à la fermeture, un management ouvert et soucieux du bien-être des professionnels favorise l’ouverture d’esprit, y compris vis-à-vis de nouvelles idées ou de nouveaux partenaires, justement… Enfin, je soutiens que le décloisonnement est une forme d’hygiène institutionnelle : il crée les conditions de la bientraitance. Travailler sous le regard d’autrui, de bénévoles et de multiples partenaires est la meilleure solution pour réduire les risques de maltraitance. C’est donc aussi une forme efficace de maitrise des risques institutionnels.
Ariel Kyrou : Quels sont les obstacles à l’ouverture et à l’inverse ses conditions de possibilité (compétences, métiers, coordination, etc.) ?
Giorgia Ceriani Sebregondi : Pour que la place faite à des acteurs non professionnels soit vécue sereinement par les équipes, il faut du temps. Être toujours dans l’urgence, en flux tendu met les équipes en tension, donc nuit à l’écoute comme à l’accueil. Combien de fois avons-nous entendu que le bénévolat était une bonne chose, mais que s’occuper d’un bénévole prend trop de temps ? Et au vu manque d’effectif, ce temps arraché aux tâches urgentes devient la denrée la plus rare !
Sabra Ben Ali : Pour rebondir sur la question du temps : les mardi, avec les collectifs, les enfants préparaient les évènements, occupés avec d’autres adultes que les professionnels. Là où nous raisonnons beaucoup en taux d’encadrement, le projet a permis de déployer un taux de présence.
Olivier Frezet : J’ai l’habitude de parler d’une valse a trois temps : le temps long d’un mandat ; celui, annuel, des budgets ; et celui, quotidien, de la souffrance des personnes. J’ajouterais la question de la confiance : construire les alternances entre un domicile et un EHPAD, par exemple, suppose un dispositif conçu pour favoriser les échanges croisés entre professionnels, médecins, bénévoles, aidants, intervenants à domicile, etc.
Sabra Ben Ali : Oui, confiance et cohérence. Décloisonner nécessite le partage d’une vision. Sinon l’invité devient vite un bouc émissaire. L’un des enjeux est de tisser une narration commune, même si chacun a une place différente, justement parce que chacun a une place différente. Vis-à-vis des équipes et des résidents comme des invités, l’opératrice du décloisonnement joue un rôle pivot, pour écouter, comprendre, débriefer, transmettre les envies et soucis de toutes et tous. C’est une interface et une traductrice, raccordant des sensibilités et des temporalités très disparates, par exemple entre les artistes et l’institution. Ce qui m’a aidé pour jouer mon rôle d’interface a été ma double appartenance : d’une part salariée de la structure gestionnaire (L’OREAG) ; et d’autre part responsable de l’association créée (La Petite Sœur). J’étais donc liée aux deux parties, ce qui les rassurait l’une et l’autre.
Jean-Luc Fidel : Les compétences d’interface sont en effet très importantes. Être capable de se mettre à l’écoute d’acteurs porteurs de logiques différentes. Sans un état d’esprit souple et expérimental, les choses deviennent vite compliquées : par exemple pour le bénévole qui ne maitrise pas les codes et se sent démuni, comme à l’inverse pour le professionnel qui se demande si le bénévole ne lui vole pas le temps le plus enrichissant, qui se sent même parfois mis à nu devant une personne sans formation ni statut.
Olivier Frezet : Mais l’accompagnement social dans les structures de soin devient très compliqué compte-tenu de la durée de plus en plus courte des séjours. D’où la nécessité d’élargir le champ des accompagnements au-delà des établissements, par exemple grâce à des équipes mobiles dont les membres sont capables de se mobiliser très vite pour se rendre au domicile de la personne. Plus largement, si l’on veut suivre les parcours de vie des personnes, je pense que nous avons besoin d’un métier que nous appelons avec Jean Bouisson « opérateur de reliance ».
Jean-Luc Fidel : Les établissements ont effectivement besoin de professionnels avec des fonctions de coordination, comme cela se pratique déjà au sein des services spécialisés dans les greffes, qui organisent un accompagnement au long cours des patients. Ensuite, il y a bien sûr les enjeux de moyens et de temps à consacrer aux patients, et ce d’autant que la technicisation croissante du suivi risque de fabriquer du cloisonnement au détriment de la relation. Mais comme je l’ai déjà souligné, l’usage d’outils numériques, pour le lien en amont et en aval de la présence en établissement, ou sur un autre registre la souplesse d’organisation, ouverte aux prises d’initiatives, sont des clés pour améliorer et étendre nos relations aux personnes et à leurs proches.
Sabra Ben Ali : Un détail allant dans ce sens : le fait que l’association La Petite Sœur ait une esthétique et une représentation numérique moins stigmatisantes que le site d’un établissement médico-social. Cela a permis d’ouvrir un espace virtuel d’identification pour les jeunes à partir d’un avatar institutionnel ayant les codes des enfants et des adolescents d’aujourd’hui.
Jean-Luc Fidel : Votre espace ouvert, La Rêverie, avait d’ailleurs sa propre esthétique, et était en quelque sorte séparé du reste du centre : cela montre aussi l’importance des lieux, d’un point de vue presque architectural, pour accueillir la venue d’autrui. Les démarches de décloisonnement ont besoin d’espaces d’accueil, de salons, de salles polyvalentes multi-usages pour des activités, des manifestations, des expositions, de la musique… Il est fondamental de ne pas rogner sur ces lieux d’accompagnement, comme on le fait trop souvent par souci d’économie.
Sabra Ben Ali : C’est vrai que l’architecture de l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) Louise Liard Le Porz permettait une séparation indispensable, donc une ouverture à l’intérieur même du lieu. La question est plus difficile au sein du centre éducatif fermé avec lequel nous sommes aujourd’hui en train de créer un projet proche. Il fait sept hectares, mais sans bâti vide. Les enfants nous croisent mais il n’y a pas de surface de cohabitation, ce qui est un souci. La question est : comment créer un point de contact clair ? Une caravane ? Une Yourte ? L’ancrage de la relation et d’un nouvel imaginaire à l’opposé même d’une prison dans le centre est en effet primordial.
Giorgia Ceriani Sebregondi : Je voudrais mentionner une dernière piste de décloisonnement : l’accueil de recherches-actions. L’expérience de Sabra en est l’illustration : faire venir dans les établissements des chercheurs qui s’investissent. Cette démarche, à laquelle nous pensons peu, apporte un vent d’ouverture.
Ariel Kyrou: Et si, au terme de cet échange, je vous demandais à chacun et chacune si vous aviez un projet, un souhait, une utopie en matière de décloisonnement ?
Olivier Frezet : Au niveau de la Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle (qui a le statut de fondation à but non lucratif), nous travaillons sur une idée de quartier : un campus de formation et de recherche, avec des habitats pour personnes âgées handicapées, des commerces, des terrains de sport… Ce projet global se rapproche du quartier Humanicité à Lille, pour mettre le lien au cœur de la ville.
Sabra Ben Ali : Ce qui me fait rêver, c’est le potentiel de la présence des artistes dans les lieux de soin. J’ai en effet constaté la capacité d’identification des jeunes avec les artistes, qui jouent un rôle de passeurs. La porosité de ces deux milieux qui interrogent la norme chacun à leur manière ainsi que leur capacité à tisser des liens entre eux sont étonnants.
Giorgia Ceriani Sebregondi : Pour ma part, j’ai été frappé par le discours alternatif porté au moment du scandale ORPEA en 2021 par un collectif de vieux, qui ont adopté le nom de Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Leur propos : penser le grand âge et plus précisément la coexistence des âges à l’échelle de la ville entière, avec une vraie réflexion sur l’urbanisme, plutôt qu’à l’échelle des seuls EHPAD.
Jean-Luc Fidel : Si j’étais un rêveur utopiste, j’aimerais que chaque bassin de vie accueille une ou plusieurs fonctions de coordinateur avec pour mission d’animer les communautés. Dans le strict domaine médical, la Fondation s’est énormément investie sur cette démarche, par exemple en invitant les praticiens de nos établissements sanitaires à s’investir dans les instances nouvelles que sont les Communautés professionnelles territoriales de santé (C.P.T.S.). Nous avons besoin de faire tomber les murs mentaux. Ils rassurent certains mais ne font pas progresser la qualité de l’accompagnement. J’aimerais que chaque territoire bénéficie d’une telle fonction de coordinateur, pour mettre autour de la table tous les acteurs du soin, de l’accompagnement... et du décloisonnement !